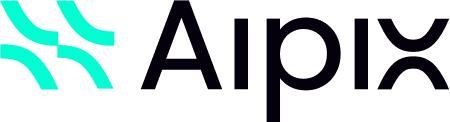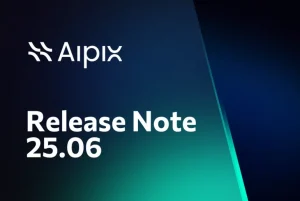Le secteur des télécommunications au Pakistan : opportunités et perspectives d'avenir
Jetez un œil complet sur les défis actuels et les opportunités émergentes au sein du secteur des télécommunications au Pakistan.
Face à la hausse de la fiscalité et à la diminution des revenus, les opérateurs télécoms sont soumis à une pression immense pour trouver des solutions innovantes capables de pérenniser leurs activités et d'étendre la connectivité, notamment dans les zones reculées et mal desservies. Cette discussion explore comment les nouvelles technologies et les services numériques peuvent remodeler le paysage industriel.

Zulfiqar Mehdi, Un dirigeant stratégique en technologies fort de plus de 30 ans d'expérience en communication et en informatique anime cette conversation éclairante. En tant que figure clé de Appel MondialMehdi, l'un des principaux fournisseurs de services de télécommunications et multimédias au Pakistan, apporte une connaissance approfondie de la gestion de projets et de la R&D, ainsi qu'une vision claire de l'innovation sur un marché hautement concurrentiel. Son expertise offre un aperçu précieux de l'évolution des modèles de télécommunications traditionnels pour répondre aux exigences modernes.
S'appuyant sur sa vaste expérience, WorldCall se concentre sur l'exploitation de la transformation numérique pour relever les défis de connectivité et créer de nouvelles sources de revenus, soulignant le rôle essentiel des efforts de collaboration entre les opérateurs de télécommunications et les FAI pour créer des écosystèmes de télécommunications durables et évolutifs au Pakistan.
Plongez avec nous dans l'expérience mondiale des télécommunications dans une nouvelle interview podcast sur l'industrie des télécommunications au Pakistan :
Anastasiya (Aipix) :
Passons directement aux questions : j’aimerais connaître votre point de vue d’expert sur le paysage global des télécommunications au Pakistan. J’ai entendu parler de certains problèmes, notamment liés à la baisse continue du revenu moyen par utilisateur. Quel est, selon vous, la situation actuelle du marché des télécommunications au Pakistan et quels facteurs peuvent contribuer à cette baisse de l’ARPU ?
Mehdi (AppelMondial) :
Votre première question est très pertinente, et j'aimerais l'approfondir. L'ARPU est sans aucun doute l'un des facteurs les plus importants pour évaluer le marché, mais on oublie souvent qu'il est également lié à son expansion. Une baisse de l'ARPU ne signifie pas forcément une baisse du chiffre d'affaires global.
Par exemple, dans mon pays, en 1999-2000, le tarif d'un appel local vers une ligne fixe entre différentes régions était d'environ $3. Aujourd'hui, en dollars, il est inférieur à un centime. Ainsi, si l'ARPU a chuté, l'utilisation a considérablement augmenté : à l'époque, on comptait à peine un million d'utilisateurs, contre des dizaines de millions aujourd'hui.
Au Pakistan en particulier, l'ARPU a effectivement diminué, mais si l'on examine certains chiffres, en 2010-2011, l'ARPU mondial était d'environ 14 TP4T, tandis qu'au Pakistan, il dépassait à peine 14 TP4T. Aujourd'hui, l'ARPU mondial est d'environ 14 TP4T, et celui du Pakistan est proche de 14 TP4T6,8. Donc, relativement parlant, la baisse n'est pas aussi marquée qu'il y paraît.
Le principal problème est apparu lorsque les entreprises de télécommunications se sont concentrées sur les infrastructures, se considérant uniquement comme des fournisseurs d'infrastructures. Elles se sont concentrées sur la construction du réseau, sans investir dans des sources de revenus alternatives. C'est comme construire une route : on investit massivement, mais on ne tire pas de revenus directs de la route ; les revenus sont indirects.
Ainsi, si les entreprises de télécommunications continuent à mettre en place des infrastructures sans monétiser les autres services, elles perdront naturellement de l'ARPU et des parts de marché, ce qui est en train de se produire actuellement.
Anastasia :
Les entreprises de télécommunications prévoient-elles d’introduire des services innovants ou des stratégies de diversification pour remédier à ce problème ?
Mehdi :
C'est une stratégie bien connue. Cependant, au Pakistan, le secteur a été principalement réactif. Après la privatisation à la fin des années 90 et au début des années 2000, les revenus étaient si élevés que les investisseurs ne se sont pas intéressés à la création de valeur ; ils se sont contentés de vendre des SMS et des minutes.
Le véritable défi est apparu avec l'introduction de la 3G et de la 4G vers 2013-2014. Des services comme Skype et d'autres ont commencé à entraîner une baisse importante des revenus. Malheureusement, les opérateurs télécoms n'ont pas immédiatement pris conscience de cet impact.
Ce n'est que très récemment, vers 2022-2023, que de véritables efforts de diversification ont commencé, portés en grande partie par des startups plutôt que par les opérateurs télécoms eux-mêmes. Ces startups avaient des applications et recherchaient des plateformes. Aujourd'hui, les fournisseurs d'infrastructures télécoms collaborent avec les fournisseurs d'applications, notamment dans des secteurs comme l'agriculture, qui présente un potentiel énorme au Pakistan.
Anastasia :
Pourriez-vous partager votre point de vue sur l’état des infrastructures de télécommunications au Pakistan, en particulier la fibre optique et les réseaux mobiles ?
Mehdi :
Le Pakistan a été parmi les premiers pays à adopter les nouvelles technologies. Dès 1988-1989, la fibre optique a été installée pour assurer la connectivité nationale. Depuis, le déploiement de la fibre a connu une croissance exponentielle.
Le Pakistan est un vaste pays, comparable en taille à l'Allemagne ou à la France. Nous disposons de plus de 200 000 kilomètres de câbles à fibre optique. Sur ce total, 75 000 km sont de la fibre longue distance, le reste étant de la fibre métropolitaine, couvrant plusieurs fois les villes.
La quasi-totalité de cette fibre est active et nous ressentons déjà la pression d’une forte demande.
Concernant les réseaux mobiles, le Pakistan compte actuellement environ 190 millions d'utilisateurs mobiles, avec un taux de pénétration de 781 TP3T, ce qui est plutôt satisfaisant. Le taux de pénétration du haut débit est d'environ 571 TP3T.
Le Pakistan s’est connecté à l’Internet international via la fibre optique en 2000, ce qui a marqué un grand essor pour le secteur après la privatisation.
En 2000, on comptait seulement 300 000 utilisateurs mobiles, contre environ 120 millions aujourd'hui. Il est intéressant de noter que le nombre d'utilisateurs de lignes fixes n'a pas augmenté depuis 2000, malgré la croissance démographique ; en réalité, l'utilisation des lignes fixes a diminué.
Au cours des dernières années, la croissance a considérablement ralenti, probablement en raison de défis politiques et économiques.
Par exemple, le Pakistan a été le premier pays à adopter la technologie haut débit sans fil WiMAX en 2007, avant même la formalisation des normes de l'UIT. Mais au cours des cinq à sept dernières années, les débits et la croissance du haut débit ont stagné.
Un faible ARPU signifie que personne n'est prêt à investir. Après la privatisation, les marges étaient élevées et les bénéfices conséquents, mais le gouvernement a imposé de lourdes taxes aux opérateurs télécoms. Au début, ces taxes étaient gérables, mais avec la baisse de l'ARPU, elles ont continué d'augmenter.
Aujourd'hui, tous les opérateurs de télécommunications, quelle que soit leur taille, peinent à dégager des bénéfices. Par exemple, Telenor, un groupe scandinave, s'est retiré du Pakistan, invoquant des difficultés de marché.
La principale raison pour laquelle les entreprises de télécommunications peinent à survivre est la hausse des impôts et la baisse de l'ARPU. Aujourd'hui, elles peinent à survivre.
Anastasia :
Oh là là, je vois. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avant d'aborder les solutions possibles sur ce marché, pourriez-vous nous faire part de quelques nouvelles ou avancées concernant les solutions de communication par satellite au Pakistan ? Le Pakistan étant un vaste pays à la géographie diversifiée, le satellite pourrait être une solution efficace pour atteindre les zones rurales sans dépendre des infrastructures terrestres.
Mehdi :
Tout à fait. Je voudrais souligner deux régions du Pakistan particulièrement difficiles d'accès en termes d'infrastructures de télécommunications. La première se trouve au nord, principalement dans l'Himalaya. Ces zones sont difficiles d'accès et présentent une population dispersée, ce qui en fait un marché peu attractif pour les opérateurs télécoms, car les investissements y sont très élevés, mais la densité de population y est faible. De plus, le relief et les conditions climatiques y sont difficiles.
La deuxième région est la province du Baloutchistan. Elle couvre plus d'un tiers de la superficie du Pakistan, mais compte moins de 10% de la population, soit environ 7 ou 8%. Cette vaste zone, peu peuplée, est très mal desservie. Certains endroits sont dépourvus de routes et d'électricité, et les conditions de vie y sont restées inchangées. Les communications par satellite sont absolument nécessaires dans ces régions.
Certains fournisseurs de services par satellite, comme le groupe coréen KT et IDirect, proposaient déjà des services, mais leurs terminaux étaient très coûteux et inaccessibles à la plupart des habitants de ces régions. Actuellement, notre plus grand espoir repose sur Starlink. Le gouvernement est déjà en contact avec eux et a obtenu les autorisations nécessaires. Ils prévoient de lancer leurs services d'ici la fin de l'année, ce qui pourrait changer la donne.
Anastasia :
Avant de plonger plus en profondeur dans les services, pourriez-vous partager avec nous le rôle de WorldCall sur le marché des télécommunications au Pakistan pour ceux qui ne le connaissent peut-être pas ?
Mehdi :
WorldCall est une entreprise très ancienne, dotée d'une riche histoire. Nous avons débuté comme opérateur d'interconnexion longue distance, autorisé par le gouvernement à acheminer le trafic international vers le Pakistan. C'était notre cœur de métier au départ.
Au fil du temps, nous avons étendu nos services à d'autres services. L'un de nos projets majeurs a été la technologie de boucle locale sans fil, visant à combler les lacunes là où la pose de boucles locales traditionnelles en cuivre était trop coûteuse. Nous avons installé une infrastructure de boucle locale sans fil à l'échelle nationale et avons également lancé le haut débit sans fil utilisant la technologie CDMA sur les mêmes fréquences.
Bien que nos projets aient toujours été ambitieux, l'entreprise a connu des hauts et des bas, notamment une croissance limitée de sa clientèle. L'activité longue distance est toujours opérationnelle, mais elle est confrontée aux évolutions du marché. J'ai récemment rejoint WorldCall dans l'espoir d'apporter du changement, et je continue d'œuvrer pour cet objectif.
Anastasia :
C'est formidable à entendre ! En parlant de changement et de transformation, quels sont les projets de WorldCall pour introduire de nouveaux services numériques sur le marché des télécommunications ? Par exemple, la vidéosurveillance en tant que service est de plus en plus populaire.
Mehdi :
Aujourd'hui, se contenter de mettre en place des infrastructures et de vendre des minutes ou des mégaoctets n'est plus tenable. Les opérateurs télécoms peinent à survivre. Investir davantage dans les mêmes services est donc insensé.
Chez WorldCall, nous nous concentrons désormais sur les logiciels et les services informatiques. Nous avons récemment acquis des startups aux produits prometteurs, incubé leurs idées et les avons transformées en solutions commercialisables.
Nous avons investi des domaines comme l'IA (très populaire), la technologie blockchain et les logiciels bancaires. Concernant la blockchain, nous avons établi un réseau national de quelques centaines de nœuds et mené des projets pilotes comme la distribution de bons d'alimentation via la blockchain. Les logiciels bancaires sont un autre domaine que nous développons activement.
Progressivement, WorldCall s’éloigne des simples réseaux de télécommunications pour se tourner vers des solutions informatiques plus larges.
Anastasia :
Merci de partager cela. Je m'intéresse particulièrement à la vidéosurveillance en tant que service, notamment du point de vue de l'utilisateur final. Quels secteurs sont les plus demandeurs pour ce service ? S'agit-il principalement de B2B ou de B2C ?
Mehdi :
C'est la vidéosurveillance qui a permis le rapprochement d'Aipix et de WorldCall. En explorant ses applications, j'ai constaté que les demandes du marché varient considérablement d'un pays à l'autre. Il n'existe pas de solution universelle au Pakistan, surtout compte tenu des défis de sécurité intérieure.
Le gouvernement impose la surveillance dans de nombreux lieux. Tous les bâtiments gouvernementaux doivent être équipés de caméras, les bâtiments commerciaux doivent en installer, et des projets d'envergure sont en cours, comme les initiatives « Surveillance des frontières » et « Ville sûre » ou « Ville intelligente ». Ces projets visent à couvrir des villes entières avec des caméras et des systèmes dorsaux pour la reconnaissance des véhicules et le suivi des incidents.
Le potentiel de la vidéosurveillance est immense, mais le défi est de taille : chacun tente de construire ses propres réseaux indépendants. Les projets « City Safe » disposent de leurs propres centres de données et réseaux de fibre optique, les banques enregistrent localement, et même les foyers disposent de plusieurs caméras avec enregistrement local.
Cette fragmentation entraîne une augmentation des coûts, car au lieu de partager les infrastructures et les ressources, chaque entité construit son propre système de bout en bout. C'est comme si chaque rue avait son propre fournisseur d'accès Internet : une véritable perte d'efficacité.
C'est le plus grand défi. Le potentiel est énorme, mais le marché n'est pas encore prêt à l'exploiter efficacement.
Côté:
Que pensez-vous du potentiel des opérateurs et FAI pakistanais en matière de vidéosurveillance ? Nous avons évoqué précédemment la baisse de l'ARPU et le fait que de nombreux clients B2B gèrent eux-mêmes leur système de surveillance et leur stockage. Forts de notre expérience auprès des opérateurs de télécommunications, une approche de service courante consiste à dire aux clients B2B : « Vous dépensez beaucoup en stockage et en maintenance des caméras ; confiez-nous tout. Nous enregistrons tout, assurons la maintenance du système, et vous ne payez qu'un abonnement mensuel ou annuel, que nous pouvons combiner avec votre internet. » Cela semble être une solution idéale pour le secteur des télécommunications pakistanais. Qu'en pensez-vous ?
Mehdi :
Permettez-moi de détailler les défis afin que nous puissions clairement définir le problème. La vidéosurveillance n'est pas une solution unique : elle implique plusieurs composants. Il faut des capteurs ou des caméras à une extrémité, une infrastructure pour acheminer la bande passante et un centre de données pour le stockage.
Le principal défi réside dans la bande passante. La vidéo nécessite une bande passante très élevée ; nous ne pouvons donc pas compter uniquement sur les fréquences radio ou la bande passante des réseaux mobiles. Elle doit transiter par la fibre optique.
Même les réseaux 5G nécessitent une pénétration importante de la fibre optique à chaque coin de rue pour alimenter leurs points d'accès. L'infrastructure fibre optique est donc absolument essentielle.
Au Pakistan, la fibre optique appartient principalement aux FAI. Or, les centres de données sont généralement détenus par les opérateurs télécoms, et non par les FAI. Cela pose un problème : si le stockage ou l'accès à la fibre doivent être payés séparément, le service devient trop cher.
Seuls les FAI qui ont construit leurs propres centres de données et leur propre infrastructure de fibre optique peuvent proposer la vidéosurveillance comme service à valeur ajoutée en plus de la connectivité Internet.
Un autre point important concerne les prix. L'ARPU mobile au Pakistan est très faible – environ 70 à 80 centimes par mois – mais l'ARPU haut débit varie de $10 à $20, ce qui est plus raisonnable. Les abonnés haut débit paient déjà pour de nombreux services – Smart TV, vidéo à la demande, etc. L'infrastructure haut débit est donc également idéale pour le transport des données de vidéosurveillance.
Au Pakistan, au moins un FAI gère avec succès une activité de vidéosurveillance. Côté serveur, il n'utilise pas de logiciel d'analyse complexe. Par exemple, un consommateur lambda possédant deux caméras à domicile souhaite une simple rediffusion, et non une reconnaissance faciale ou une analyse approfondie.
Ainsi, leurs serveurs agissent comme un stockage aveugle, tandis que les caméras elles-mêmes gèrent des fonctionnalités intelligentes comme la détection de mouvement, ce qui permet de réduire les besoins en bande passante et en stockage en enregistrant uniquement lorsqu'un mouvement est détecté.
En résumé, pour tout projet de vidéosurveillance au Pakistan, il est indispensable de s'associer à un fournisseur de services possédant à la fois un centre de données et une infrastructure fibre optique. Sans ces deux éléments, le service devient inabordable.
Anastasia :
C'est logique. Voyez-vous un avenir plus prometteur avec une collaboration accrue entre les FAI et les opérateurs de télécommunications pour fournir de tels services ? Vous avez mentionné un FAI qui a lancé avec succès la vidéosurveillance. D'autres pourraient-ils suivre ?
Mehdi :
Tout à fait. Je travaille actuellement avec un opérateur télécoms spécifique, unique en son genre, car il bénéficie d'une exclusivité dans une zone du Pakistan, ce qu'aucun autre opérateur ne possède. Il propose des services mobiles, fixes, haut débit, fibre optique jusqu'au domicile, et possède même ses propres interconnexions terrestres et internationales.
Bien qu'il s'agisse d'un petit opérateur, ils disposent d'un écosystème complet, y compris leur propre centre de données. Je suis convaincu que si nous parvenons à construire avec eux un modèle économique de vidéosurveillance en tant que service, ce sera une réussite.
J'essaie également de contacter un autre opérateur qui possède un centre de données et une infrastructure fibre optique. J'ai une réunion avec eux prochainement et je constate un intérêt.
Mais encore une fois, il s'agirait d'un service à valeur ajoutée, et le prix est crucial. Actuellement, le prix est d'environ $2 par mois et par caméra ; nous devons donc nous demander quel chiffre d'affaires peut être généré de manière réaliste.
J'ai également envisagé de lancer des produits pour la maison connectée, comme les sonnettes Google Nest ou Ring. L'abonnement à Google Nest coûte environ 1 TP4T8 à 1 TP4T10 par mois, sans compter les frais d'internet. Ces services intelligents pourraient apporter une réelle valeur ajoutée et accroître le potentiel de revenus.
Sans fonctionnalités intelligentes, l'enregistrement et le stockage seuls n'offrent pas beaucoup de potentiel commercial.
Ce type de produit présente un potentiel énorme : pouvoir parler aux visiteurs à distance, par exemple. Je pense que l’avenir pourrait certainement se concentrer davantage sur ces services intelligents et interactifs.
Le secteur des télécommunications évolue rapidement à l'échelle mondiale, et le Pakistan ne fait pas exception. Malgré les défis liés aux infrastructures et les pressions du marché, le secteur explore de nouvelles technologies et des solutions innovantes pour répondre à la demande croissante. L'intégration de services numériques avancés et d'options de connectivité améliorées, et les efforts de collaboration entre les fournisseurs laissent entrevoir un avenir plus connecté et plus efficace.
À mesure que le paysage évolue, il sera essentiel de rester adaptable et d’adopter l’innovation pour exploiter pleinement le potentiel des services de télécommunications.